

|
.Le Jansenisme et les Jésuites |
||||||||||||||||||||||||
|
Le jansénisme et les jésuites La Compagnie de Jésus, fondée en 1540 par Ignace de Loyola, fut le principal artisan de la Contre-Réforme. En Europe, les jésuites, dans leurs collèges, jouèrent essentiellement un rôle dans la modification de l'enseignement. Ils furent aussi les artisans, avec les capucins, du renouveau missionnaire dans le monde, à la suite des grandes découvertes géographiques du XVIème siècle. |
||||||||||||||||||||||||
|
Les
jésuites, qui juraient fidélité au pape en entrant dans la Compagnie, furent
considérés comme agents de l'étranger, et expulsés une première fois du royaume
de France à la fin du XVIème siècle, en partie sur l'insistance des parlementaires
gallicans. Henri IV souhaita leur retour.
-Le jansénisme devient parlementaire Jansenius, en 1640, avait développé des thèses mettant en valeur la grâce divine, seule à pousser l'homme au Bien ; il exigeait une foi à toute épreuve, un rigorisme moral et la contrition parfaite des pénitents. Le parti janséniste avait son centre à l'abbaye de Port-Royal. Dès 1661, Louis XIV avait condamné les " cinq propositions de Jansénius ". La question janséniste reprend à la fin du XVIIème siècle, le pape condamnant définitivement le jansénisme par la bulle Unigenitus, en 1713. Les parlements frondèrent à nouveau en s'opposant à la bulle. Beaucoup de parlementaires étaient tentés par le jansénisme, dont l'austérité convenait à l'image qu'ils voulaient se donner mais permettait aussi de faire opposition au roi. Le Parlement de Paris essaya d'obtenir l'abrogation de la bulle. Diverses affaires envenimèrent les choses : les convulsionnaires de Saint-Médard, l'affaire des billets de confession de Saint-Étienne-du-Mont à Paris. En face, le parti dévôt de la reine Marie Leszczynska soutenait les jésuites. En 1753, le roi échappait à l'attentat de Damiens, qui avait servi des familles parlementaires proches du jansénisme. Une campagne de libelles et pamphlets fut lancée avec le soutien des jésuites contre les parlementaires et les jansénistes. Le père La Valette, jésuite lancé en Martinique dans des affaires, commit des erreurs de gestion et fit faillite. Il fut poursuivi par des négociants marseillais devant le parlement d'Aix. Il fit transférer le procès devant le Parlement de Paris qui étudia les statuts de la Compagnie et poussa les jésuites à choisir entre leur serment d'obéissance au pape et le roi de France. -Le parlement d'Aix En majorité janséniste, il entra dans le débat et suivit les actes du Parlement de Paris. Les réquisitions écrites contre les jésuites par le procureur général Ripert de Monclar et l'avocat général Leblanc de Castillon eurent un retentissement national. Par arrêté du 28 janvier 1763, le parlement de Provence prononça la condamnation générale de la Compagnie, l'exclut à perpétuité de son ressort, ordonna aux Pères de quitter immédiatement leurs collèges et leur interdit de recevoir toute charge et tout bénéfice. Les mesures prises contre les jésuites à partir de 1763 aboutissent à leur expulsion du royaume, puis à l'abolition de l'ordre en 1767.
L'arrêt d'expulsion des jésuites fut appliqué dans toute sa rigueur. Les jansénistes se vengeaient d'un siècle d'humiliations. Le parlement d'Aix se montra particulièrement sévère. Il traqua les jésuites comme des criminels, les dispersa et les força à vivre comme de simples particuliers, non sans les avoir réduits à la misère. Les magistrats d'Aix poursuivirent ceux de leurs membres qui étaient proches des jésuites. Le président Boyer d'Eguilles fut banni du royaume, les conseillers Montvallon, Coriolis, Beaurecueil, Mirabeau, Jouques, Canorgue et Charleval furent suspendus pour plusieurs années. En 1773, Clément XIV prononçait la suppression de l'ordre. |
||||||||||||||||||||||||
|
Arrest du parlement de Provence qui juge l'appel comme d'abus interjetté par Mr. le Procureur général des bulles ; brefs, constitutions et autres réglemens de la Société se disant de Jésus ; fait défenses aux soi-disants jésuites et à tous autres de... vivre sous l'obéissance au général et aux constitutions de ladite Société... enjoint aux soi-disants jésuites de vuider les maisons de ladite Société... du 28 janvier 1763. Aix-en-Provence, veuve de Joseph David, 1763 |
||||||||||||||||||||||||
| Res. F. 846 | ||||||||||||||||||||||||
|
"Le parlement fut occupé presque constamment par les affaires religieuses de 1761 à 1768. Certains ecclésiastiques exigeant des mourants le nom de leur confesseur et un billet garantissant l'acceptation de la bulle Unigenitus qui condamnait les théories jansénistes, les magistrats engagèrent la lutte. "...L'affaire de feue Madame de Charleval à qui Madame de Charleval sa brue... a fait essuyer à la mort, de si cruelles persécutions de concert avec ses Messieurs [les prêtres de l'église du Saint-Esprit d'Aix], pour la forcer de recevoir la bulle : il lui ont fait refuser les derniers sacremens..." (p.10) En 1754, le parlement condamna à 200 livres d'amende deux prêtres de l'église de la Madeleine à Aix qui avaient refusé la communion et l'extrême-onction au nommé Garnier, suspecté de jansénisme ; en 1755, il condamnait à 10 000 livres d'amende et à l'exil l'archevêque de Biancas qui avait voulu imposer aux futurs prêtres une soumission complète à la bulle Unigenitus. Relation de ce qui s'est passé au parlement d'Aix dans l'affaire des jésuites, depuis le 6 mars 1762 et, de ce qui a été statué par le roi, sur cette affaire, le 23 décembre... [et relation ms. de ce qui s'est passé au parlement d'Aix touchant les affaires des jésuites les 3, 4, 5 juin 1762]. |
||||||||||||||||||||||||
|
[s. l., s. n.], 1763. D. 2080 |
||||||||||||||||||||||||
|
Exemple des nombreuses attaques dont furent victimes les jésuites. Frontispice pavé sur cuivre. Dénonciation des crimes et attentats des soi-disans jésuites, dans toutes les parties du monde, adressée aux empereurs, rois, princes, républiques, Pontifes Romains ou Abrégé chronologique des stratagêmes, friponneries, conjurations, guerres, tyrannies... meurtres de rois, &c. commis par les ignaciens depuis 1540, époque de leur établissement, jusqu'en 1760. |
||||||||||||||||||||||||
| [s. l., s. n.], 1762 D. 2230 | ||||||||||||||||||||||||
| Annales de la Société des soi-disans jésuites ; ou Recueil historique-chronologique de tous les actes, écrits, dénonciations, avis doctrinaux, requêtes, ordonnances, mandemens, instructions pastorales... contre la doctrine, l'enseignement, les entreprises & les forfaits des soi-disans jésuites, depuis 1552, époque de leur naissance en France, jusqu'en 1763. Tome cinquième. | ||||||||||||||||||||||||
| Paris, [s. n.], 1771. D. 1870 | ||||||||||||||||||||||||
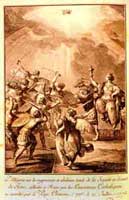 |
||||||||||||||||||||||||
| Allégorie sur la suppression de la Société se disant de Jésus, sollicitée à Rome par les puissances catholiques et accordées parle pape Clément XIV le 21 juillet 1773. Frontispice sur cuivre. | ||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||
|
Jean-Pierre-François Ripert de Mon-clar (1711-1773). |
||||||||||||||||||||||||
|
Portrait gravé par Auguste de Lorraine, XVIIIe siècle. Célèbre procureur au parlement de Provence, en 1783, dont le réquisitoire contre les jésuites eut un grand retentissement. Le Chancelier d'Aguesseau l'avait surnommé "L'Amour du Bien". |
||||||||||||||||||||||||